Notes de lecture : « L’islam incertain » de Hamadi Redissi
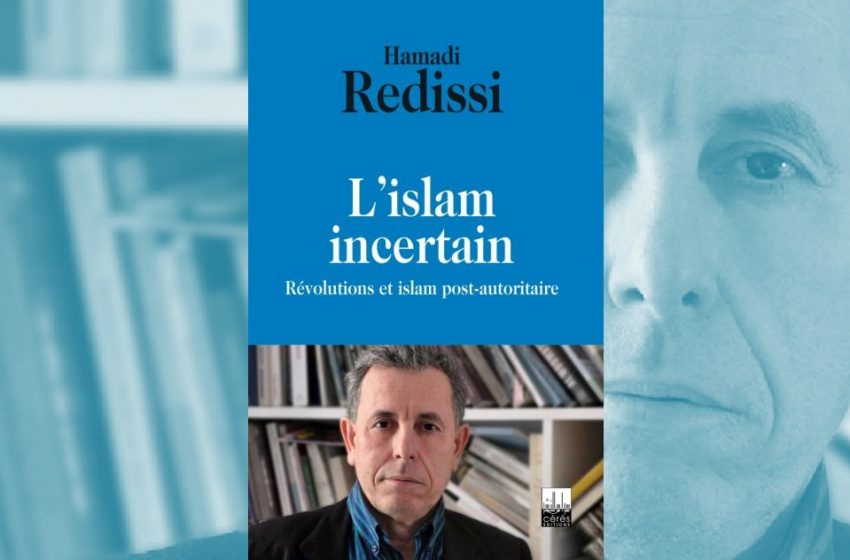
« L’islam incertain » de Hamadi Redissi
Il y a le théologien de l’islam, le faqih-juriste de l’islam, l’historien de l’islam, le philosophe de l’islam, le sociologue de l’islam, Hamadi Redissi est, lui, un politologue de l’islam. Il l’a été dans la plupart de ses livres sur l’islam politique. Un politologue et chroniqueur alerte, ouvert aux différentes disciplines des sciences sociales et aux textes d’origine de la tradition islamique, adepte du comparatisme et des classifications qui, dans ce livre, tiennent pertinemment la route. Sa liberté de ton et son style décapant exaspèrent souvent les islamistes, et il en a fait les frais personnellement, lui qui a joint la théorie à la pratique après la révolution.
Son dernier livre, « L’islam incertain. Révolutions et islam post-autoritaire » (128 pages), paru il y a deux mois chez Cérès Editions, traite des différents courants islamiques et islamistes apparus à la faveur des révolutions arabes et tunisienne : des courants islamistes politiques soft jusqu’aux barbares de type daechien. Des courants multiples, contradictoires, confus, qui n’ajoutent rien à la nébuleuse islamiste et qui ne préjugent pas forcément d’un destin prometteur, même si plusieurs courants islamistes sont en train de s’assagir et de rentrer confusément dans le moule démocratique. L’islam est d’après lui plus incertain que jamais. Il est encore bancal, assis entre deux socles : l’autoritarisme islamo-féodal, avec sa vulgate traditionnelle, ses approximations et ses dérives violentes, d’une part, et la démocratie séculière, qu’ils cherchent encore à rebaptiser par des modalités islamiques, d’autre part. Mais, il est certain que les islamistes font partie, après les révolutions arabes, du jeu politique. « Le post-autoritarisme englobe les islamistes », comme il le note.
En fait la question qu’il se pose en filigrane : comment comprendre le jeu sui generis des islamistes en démocratie, notamment après une révolution civile ? Que faut-il admettre de leurs pratiques, pas toujours « catholiques », en matière politique, sociale, civile ? Faut-il donner crédit à leur intention démocratique et même à leur intégration institutionnelle ou faut-il s’en méfier comme il ressort de leur pratique du pouvoir (chasser le naturel, il revient au galop)? En Tunisie, Ennahdha est bien aujourd’hui dans l’entre-deux. Ailleurs aussi.
C’est vrai que l’autoritarisme n’est plus de mise, comme le rappellent les slogans de la révolution tunisienne « le peuple veut » ou « Dégage ». L’islam post-autoritaire lui-même rejette l’autoritarisme dont il a été un des victimes. Il accepte quelques plages de modernité, le bulletin de vote et la sécularisation de la politique. Mais, souligne Hamadi Redissi, « le post-autoritarisme islamique est miné par un paradoxe : il rompt avec l’autoritarisme, mais guère avec la tradition, cette transmission ininterrompue d’une génération à une autre, cet entretien infini avec les Anciens ». D’où l’ambiguïté ou l’incertitude de l’islam post-autoritaire, d’autant plus qu’il évolue sur les sables mouvants de la transition. Ce qui nous permet de douter de la conversion islamiste, c’est que « jamais le jihadisme n’a été aussi prospère qu’en contexte post-autoritaire. Il étend son domaine de lutte en Europe. Et il menace la paix mondiale. C’est l’islamisme à répétition ». Ainsi, non seulement un islamisme chasse l’autre d’une époque à une autre, mais encore des islams multiples cohabitent à l’intérieur de cette nouvelle phase post-autoritaire. C’est d’ailleurs l’une des thèses principales de l’auteur. On est tenté de dire : la nature islamique a horreur du vide.
Il y a eu jusque-là, d’après Hamadi Redissi, trois âges de l’islam en Tunisie. Un premier âge religieux qui consistait dans l’administration directe des Arabes (705-800) jusqu’à la dynastie husseinite (1705-1956). C’est l’islam savant, individualiste, aristocratique, obéissant au pouvoir, par opposition à l’islam campagnard, rebelle, confrérique, soutenu par le monde tribal. Le second âge de l’islam tunisien est celui de l’étatisation et de la sécularisation de la religion par Bourguiba. De 1956 à 1960, celui-ci fait habilement éclater le pouvoir des théologiens, supprime les tribunaux religieux, ferme les madrasas, transforme la Zeitouna en Université, abolit les habous, « républicanise » le mufti.
La révolution introduit le troisième âge de l’islam. Ici, « Les acteurs religieux prolifèrent, s’emparant chacun d’un « bout d’islam », comme on s’arrache la grâce, occupant chacun une petite surface d’un espace public gorgé d’islam. Est-ce l’expression du pluralisme politique étendu à la sphère religieuse ? Ou bien un emballement religieux suspect ?… c’est l’effacement des frontières entre l’islam d’Etat et l’islam protestataire ». Une centaine de partis sont nées après la révolution, mais les acteurs religieux prolifèrent également, parfois alliés, parfois rivaux : Ennahdha, les salafistes (multiples et divers), la mosquée Zeitouna, l’Université de théologie, le ministère des affaires religieuses. Des groupes s’investissent dans des zones de non droit, l’islam plébéien, wahabite, s’oppose à l’islam aristocratique traditionnel, l’islam politique à l’islam non politique. Sans oublier les terroristes et les jihadistes. Pourtant les trois sources de l’islam tunisien restent, d’après l’ancien mufti Kamel Eddine Djaït, auquel se réfère l’auteur : le malékisme, le leadership des ulémas zeitouniens et le soufisme modéré.
Alors, les révolutions arabes ont-elles échoué pour autant? Hamadi Redissi se borne à faire un constat prudent. Il est vrai que les révolutions arabes ont globalement échoué à assurer la transition démocratique. Même s’il y a une gradation du seuil dramatique. L’échec donne raison aux préconditionnalistes, qui disqualifient les pays arabes et placent leur espoir dans la Tunisie. On le sait, les partisans des prérequis considèrent que la démocratie suppose la prospérité, des classes moyennes progressistes, une culture civique, des élites prêtes au compromis. Aucun critère n’est à lui seul suffisant, ils se juxtaposent. Une démocratie a, il est vrai, besoin de bourgeoisie et de pluralisme social. Pour l’école volontariste, nul besoin de ces éléments, il faut surtout vouloir la démocratie contre les éléments stationnaires. Ici la démocratie n’interdit pas la pauvreté. C’est la théorie de Larry Diamond, un des spécialistes de la démocratie de transition.
Est-ce que le Yémen stagne parce qu’il est pauvre ? Alors pourquoi la Libye, les Etats rentiers du Golfe, ainsi que l’Algérie, tous prospères, n’arrivent pas à faire décoller leur démocratie ou à se transformer? La Tunisie avait certes une relative prospérité qui l’a vraisemblablement aidé, mais alors pourquoi l’Egypte, qui se situe au même niveau qu’elle, a raté sa transition démocratique ? Il est difficile de tracer un critère de la prospérité, même si pour l’auteur la prospérité a de solides arguments en sa faveur. Elle fait durer la démocratie et la consolide. Mais, elle n’explique pas tout. L’affaire est complexe.
Pourquoi l’expérience en cours de la transition tunisienne semble sur la voie ? Pour Hamadi Redissi, la Tunisie a des avantages indéniables : une relative prospérité, une homogénéité ethnique, une classe moyenne et une culture civique. Mieux encore, ses élites ont une aptitude au compromis. Le tout à travers une modernisation sécularisée. Bourguiba a su bouleverser les mœurs de manière définitive. Essebsi tente ainsi aujourd’hui de suivre ses traces. L’émancipation de la femme et la sécularisation étaient des choix de civilisation. Alors que le Yémen et la Libye n’ont pas de Constitution à ce jour, que l’Egypte est passée d’une Constitution faite par les islamistes à une Constitution élaborée contre les islamistes par les partisans d’Al-Sissi, la Tunisie a eu une Constitution de compromis entre laïcs et islamistes. Ce qui n’est pas négligeable. Une Constitution qui a écarté la Chariâ, contrairement à la Constitution égyptienne, qui a encore consacré les libertés, y compris la liberté de conscience, permettant en principe aux Tunisiens de « sortir » de leur religion ou de manifester leur athéisme. Le compromis tunisien n’est pas un pacte éternel, il est motivé par la prudence, même s’il ne manque pas de défectuosité et si la contradiction islamo-laïque n’est pas encore surmontée. On aurait voulu aussi savoir si une Constitution de compromis est de nature à pousser les deux camps au compromis politique et si une Constitution de compromis peut survivre à un gouvernement d’un parti majoritaire, sans compromis politique entre les deux camps ?
Cela dit l’islam post-autoritaire connait d’après l’auteur une double tentation (évoquée dans le chapitre 2 de la IIe partie) : celle du néo-autoritarisme et celle de l’islamisation de l’espace public. Un mélange détonant qui combine le pluralisme et le populisme religieux. Les manifestations de ce mélange sont significatives C’est la Turquie du nouveau calife Erdogan, qui est en train de « réislamiser la Turquie à doses homéopathiques ». Il faut aussi reconnaitre que la Turquie est empêtrée dans une transition interminable depuis qu’elle a décidé d’emprunter le chemin du pluralisme dans les années 50. Une transition semée d’embûches, qui n’a cessé d’être ballotée depuis entre laïcs, militaires et islamistes. C’est l’Egypte où ceux qui ont chassé les islamistes sont ceux-là mêmes qui les ont portés au pouvoir. Ce sont les islamistes tunisiens qui, au pouvoir, ont été acculés à faire des concessions après une phase dramatique et violente. « La double dérive est momentanément écartée. Sinon aucune expérience démocratique n’est prémunie du néo-autoritarisme. Aucune n’est à l’abri non plus de l’islamisme à répétition ». La problématique islamiste a encore de « l’avenir » dans la Cité arabe, malgré les éclaircies.
En conclusion, Hamadi Redissi, à moitié sceptique, considère que « L’islam post-autoritaire ouvre la perspective d’une démocratie, même si elle est électoraliste, non sécularisée et non libérale. Du premier exemple, la Turquie, au dernier en date, la Tunisie… Démocratie ou barbarie est l’enjeu actuel ». Cette alternative tient compte aussi de la crise de l’Etat, comme l’illustre les exemples de l’Irak, de la Syrie, de la Libye, du Yémen, un peu de la Tunisie, et surtout de Daech. La prudence de l’auteur s’accorde avec la nouveauté de l’expérience de l’islam démocratique. Le précédent de la Turquie ne soulève pas trop l’enthousiasme, celui de la Tunisie islamiste non plus (la troïka).En d’autres termes, la seule certitude semble être que l’islam est pour le moment encore « incertain ». L’intégrer dans le jeu politique pour des raisons démocratiques, oui, mais s’en méfier ou lui résister sur le plan culturel, du moins tant qu’il n’arrive pas à se défaire définitivement de la tradition et des velléités théologiques. Un constat réaliste, éclairé par la pratique.
