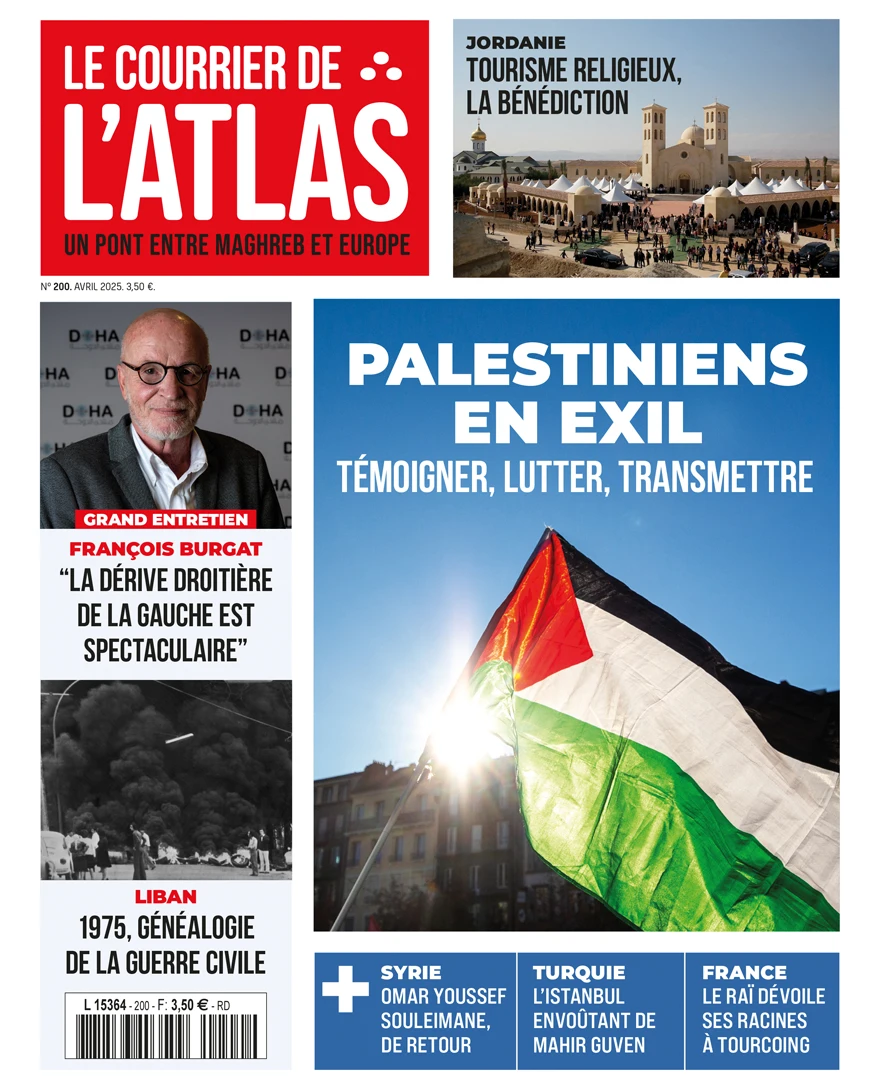Point de vue-Tunisie. Penser et s’exprimer ou la distinction fatale

(Photo par FETHI BELAID / AFP)
Le président tunisien est féru de ce type de distinction, qui peut paraître claire pour les esprits simples, comme celle entre liberté de penser et liberté d’expression, sans lui apporter la moindre explication plausible.
Le président Saied ne manque pas une occasion pour rappeler, non sans insistance ennuyeuse, et comme s’il était toujours sur la défensive par rapport à une société civile en quête d’autonomie et de garanties, cette fameuse distinction entre « liberté de penser » et « liberté d’expression », qui aurait sans doute fait sursauter Voltaire, pour ne pas dire un jeune étudiant. Il l’a redit encore lors de la commémoration de la mort de Bourguiba à Monastir dimanche dernier. Pour lui, la liberté de penser n’est pas la liberté d’expression. Traduire : seule la liberté de penser autorise une véritable liberté d’expression. En d’autres termes, dans le cogito saiedien, la liberté de penser est un luxe, qui n’est pas réservé au commun des mortels. Celui qui n’arrive pas à penser librement, de manière indépendante, risque de subir l’influence extérieure des forces occultes, des lobbies et des corrompus ; il devrait alors s’abstenir de s’exprimer librement, faute de résistance intellectuelle. Celui-là reste enchâssé dans la dépendance non souveraine vis-à-vis des forces du mal, qui cherchent à nuire à « l’intérêt supérieur » de la nation.
>> A lire aussi : Point de vue. La pénalisation de la politique
Il est vrai que le président Saied n’a jamais expliqué à l’opinion, qui a légitimement droit à la curiosité, la « raison d’être » de cette distinction entre deux libertés quasiment scellées, mais étonnamment disjointes par lui, notamment pour un juriste qui a enseigné le droit constitutionnel et les droits de l’Homme. La distinction entre ces deux libertés, conceptuellement et légitimement possibles, peut devenir pur sophisme si on la dilate jusqu’à la radicaliser. En fait, tout dépend de l’usage qu’on en fait.
La liberté de penser est considérée comme une liberté intérieure, absolue, que nul ne peut nous enlever. Elle consiste à pouvoir former librement ses opinions, croyances, jugements, sans contrainte extérieure. Tandis que la liberté d’expression est la possibilité de manifester justement ses propres pensées (par la parole, l’écrit, l’art, etc.). Pourquoi s’en inquiéter ? La liberté d’expression est publique et, de ce fait, susceptible d’être encadrée juridiquement, car même en démocratie, on ne peut pas tout dire, ni dans les médias, ni dans la vie politique, ni dans les livres (ex. : diffamation, incitation à la haine, appel au racisme, protection des mineurs, atteinte à l’honneur des personnes, etc.). Cette distinction basique entre les deux libertés est évidemment essentielle dans beaucoup de régimes démocratiques. Toutefois, si on peut penser ce que l’on veut sur n’importe quoi, il n’est pas toujours possible de tout dire publiquement, sans porter atteinte à d’autres valeurs protégées.
>> A lire aussi : Point de vue. L’alternance du diable entre dictature et islamisme
En revanche, la radicalisation (saiedienne) de la distinction devient politiquement nuisible si on utilise cette distinction pour justifier une censure excessive ou le glissement autoritaire d’un régime, du genre : « On ne vous empêche pas de penser ce que vous voulez, vous êtes libres de penser, donc votre liberté n’est pas atteinte. Vos droits constitutionnels sont saufs ». Dans ce cas, on réduit abusivement la liberté à sa seule dimension intérieure, niant le rôle fondamental de la parole dans la formation collective de la pensée. C’est une manière de refuser la contestation tout en se donnant une apparence libérale.
Dans son livre « De la liberté » (1859), J.S. Mill reconnaît pleinement la distinction entre la pensée et son expression, mais il insiste sur le fait que la liberté d’expression est le prolongement naturel de la liberté de penser. « Réprimer la parole, dit-il, c’est empêcher la vérité d’émerger – soit parce qu’elle est vraie, soit parce qu’elle permet de corriger des erreurs ». Chez lui, distinguer pensée et expression est nécessaire pour comprendre les enjeux politiques, mais il refuse d’en faire un prétexte à la censure. C’est une distinction analytique, pas idéologique. Il n’ignore pas, en bon libéral, que la distinction entre liberté de penser et liberté d’expression est dangereuse, car elle peut être manipulée ou, au contraire, utilisée de façon rigoriste. La distinction n’est pas en soi fatale dans l’ordre intellectuel. Elle le devient lorsqu’elle sert à minimiser les atteintes à la liberté d’expression sous couvert de respect de la liberté de penser.
>> A lire aussi : Point de vue. La haine des riches
Il est souvent arrivé dans l’histoire que cette distinction radicalisée ait justifié répression et terreur. Sous le régime stalinien, les citoyens soviétiques étaient officiellement « libres de penser ce qu’ils voulaient », du moins en théorie. Mais toute expression d’idées non conformes à la ligne du Parti communiste était considérée comme de la dissidence et punie sévèrement (censure, goulag, etc.). Dans certains autres régimes autoritaires, quand un intellectuel exprimait une critique, les autorités pouvaient répondre : « Pensez ce que vous voulez, mais ne troublez pas l’ordre social ». L’intellectuel est un marginal dans ces régimes répressifs, il n’est pas souvent lu par la masse, il ne parle pas non plus le langage populaire. Tant qu’il s’exprime dans sa tour d’ivoire et tant que les médias lui donnent peu de chances de diffuser largement sa pensée ou critique libres, il inquiète moins le régime. Voilà pourquoi Kais Saied s’en tient à cette distinction entre liberté de penser et liberté d’expression.
Il ne s’agit ici que d’un usage illusoire de la distinction. On laisse la liberté intérieure en apparence intacte, mais on l’empêche d’avoir toute sa portée réelle, tout l’impact politique auprès de l’opinion. Il est bien évident que penser, sans jamais pouvoir s’exprimer, revient à neutraliser cette liberté. Une demi-liberté reste une demi-terreur. Il en va ainsi, l’autorité et la liberté se combattent de longue date. Celui qui fléchit le premier est (provisoirement) éliminé.
>> A lire aussi : Point de vue. L’horreur des procès politiques