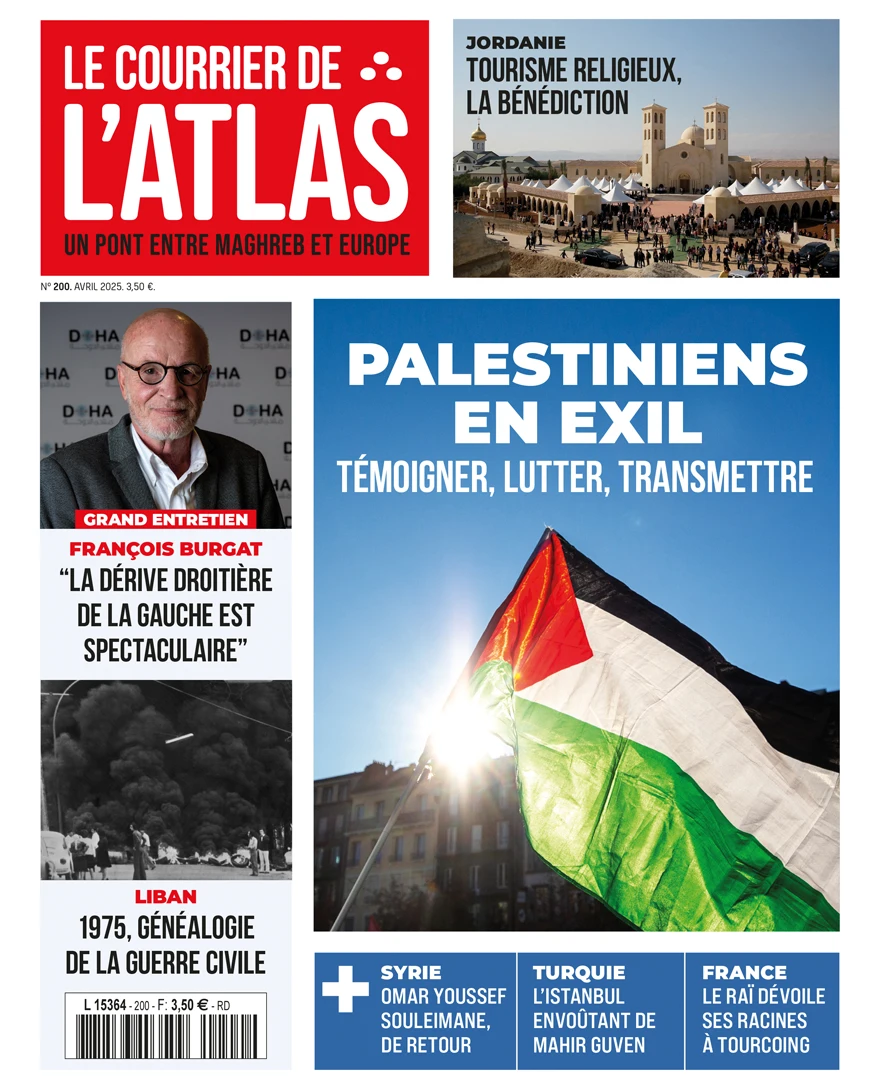Point de vue – Tunisie. Le fait du Prince

Photo : TINGSHU WANG / POOL / AFP
Le rythme des révocations des responsables politiques et administratifs ne se ralentit pas depuis le 25 juillet chez le président Saied, loin s’en faut. Le « fait du prince » reste la marque de fabrique de l’Etat saiedien.
Les révocations unilatérales, autoritaires, intempestives, anachroniques, sans revêtement formel, sans concertations et sans conditions, des ministres, responsables administratifs, magistrats, fonctionnaires, par le Président Saied évoquent terriblement la résurgence du « fait du prince » des temps anciens. Les journalistes ont d’ailleurs joué à comptabiliser le nombre de personnes révoquées par Saied du 25 juillet 2021 à ce jour, se situant autour de 70 ou 80 personnes. Révocations justifiées ou injustifiées, sur le plan légal et politique, le procédé et la brutalité de l’acte, sans ménagement aucun, s’identifient davantage au fait du prince qu’au fait d’institution. Les serviteurs de l’Etat, qui incarnent pourtant une « autorité » symbolique, attachée à la rationalité de l’acte ou de la décision, sont habituellement portés agir avec méthode, mise en forme, courtoisie et élégance, dans le respect des traditions républicaines et étatiques, pour ne pas dire démocratiques.
>> A lire aussi : Point de vue-Tunisie. Quelles garanties avons-nous aux prochaines élections présidentielles ?
Dans l’Ancien Régime, il est vrai, le monarque était l’instance première et ultime. « Ce que veut le roi, veut le peuple ». Le Prince c’est le royaume, et c’est l’Etat, quand bien même l’Etat était préconstitué. Il nomme, révoque, sanctionne, bannit, emprisonne par les « lettres de cachet » à sa guise. Il est le souverain-roi à qui les sujets doivent obéissance. La culture politique féodale de la royauté tournait autour de la culture d’un individu particulier, le roi, le « souverain », détenant des prérogatives extra-humaines. Il est le « représentant de Dieu » ou le « délégué de Dieu », chargé de rétablir sur terre l’ordre harmonieux entre les hommes, tel qu’il a été voulu par Dieu, illustrant une forme de théologie politique. Phénomène accentué encore par la théorie de la souveraineté de Jean Bodin au XVIe siècle, l’un des fondateurs de l’absolutisme. Il y a dans ces cas moins décision politique d’une autorité suprême de l’Etat qu’un « fait du prince » souverain et absolu. C’était l’esprit de l’époque absolutiste.
>> A lire aussi : Point de vue – Tunisie. L’idéologie dogmatique de la nation
Le fait du prince est alors une décision imposée par une autorité, généralement un homme au pouvoir, parce qu’il est au pouvoir. Un peu comme l’argument d’autorité dans un débat, invitant le moins gradé à obtempérer devant le plus gradé, non pas parce que ce dernier a raison, mais parce qu’il est le plus gradé. On l’appelle « fait du prince » en référence surtout à l’ancienne autorité régalienne de la noblesse. Sans discussions préalables, sans consensus, cette décision imposée « vient d’en haut », que tous doivent appliquer, peuples, groupes, institutions, collaborateurs ou gouvernants, qu’ils le veuillent ou pas, bon gré mal gré, que la décision soit juste ou injuste. « Le roi ne peut mal faire », disait-on.
Dans les Etats modernes, démocratiques, dirigistes, ou même autoritaires, les hommes au pouvoir « élus » n’agissent pas sans éclairages et conseils, sans directives et règles de conduite, et sans mises en forme et protocoles, même si la décision relève de leur bon droit. L’Etat, ce ne sont pas seulement des institutions, rouages, et textes, et des représentants, ce sont aussi des usages, des bons procédés, des manières. Idéalement, la décision politique, même du haut représentant de l’Etat, est un « savoir partagé », discuté, débattu, même entre collaborateurs, symbolisé par un éventuel dernier recours au peuple, désormais souverain. Mais comme la culture royale en occident, l’éducation califale ou sultanesque, a la dent dure dans le monde arabo-musulman. L’Etat, comme la politique, sont suspendus aux caprices – dite volonté – d’un homme au pouvoir. Ubiquité, omniscience et trans-historicité vont de pair chez ces personnages ô combien communs, mais non moins instinctifs, émotifs, irrationnels et historiques que leurs peuples.
>> A lire aussi : Point de vue – Tunisie. Gouverner par la haine, une stratégie ?
Le fait du prince est d’autant plus dérangeant et nocif sous Saied qu’il est pris parfois sur « ordre » ou sur « dénonciation » des réseaux sociaux. C’est le cas de ce sulfureux ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, victime de ses selfies trop voyants et de ses frasques, à la suite d’un pèlerinage à la Mecque accompagnant la délégation officielle tunisienne, au moment même où 49 pèlerins tunisiens sont déclarés décédés. Il ne s’agit pas bien entendu de défendre un ministre, certainement un non-politique, qui a déjà été à l’origine de l’emprisonnement d’un journaliste, mais de rappeler les signes de l’autorité de l’Etat. Un Etat n’agit pas avec empressement, sous l’émotion collective, même pour congédier un ministre maladroit qui l’a bien cherché. Quand on exige une certaine solennité dans la désignation même d’un ministre, comme lors du serment prêté devant le président de la République, symbolisant d’abord un engagement envers l’Etat et transmis à la télévision, le parallélisme des formes exige aussi le respect d’un processus protocolaire dans son congédiement. Après tout, et aussi fautif soit-il, il a exercé sa tâche au nom de l’Etat et non pour le compte de la personne du président. L’Etat se doit de mettre la forme. On ne trouve même pas dans les journaux et les communiqués présidentiels, à la suite des révocations soutenues, et comme dans l’ancien régime, l’expression « appelé à d’autres fonctions ». Là aussi, le ressentiment présidentiel s’exerce avec force. A l’évidence, dans l’esprit du président, il ne mérite même pas d’être « appelé à d’autres fonctions ». On ne sait même pas si ces ministres révoqués continueront de recevoir leurs rémunérations de ministres pendant trois mois après la cessation de leurs services, comme il est de tradition, le temps qu’ils réintègrent leurs professions d’origine. On ne parle pas de ce ministre particulier, mais de tous les ministres, comme on ne parle pas de la légitimité ou pas de la sanction de tel ou tel responsable pour telle ou telle cause, on parle du « fait du prince » en lui-même, comme un acte qui ne sied pas à l’Etat moderne. Sans oublier que le « fait du prince » (comme acte politique) ne peut s’identifier à ou se justifier par la « raison d’Etat » (question sécuritaire).
Un homme au pouvoir ne peut absorber toutes les institutions du pays, ne peut renier les traditions, usages, protocoles qui ont fait qu’historiquement cet Etat qu’il est appelé à servir est devenu un Etat. Distinction qui permet justement de distinguer entre la colère rancunière occasionnelle d’un homme au pouvoir et la réaction rationnelle et mesurée d’une institution permanente comme l’Etat, à travers son premier serviteur.
>> A lire aussi : Point de vue – Tunisie. L’art de moraliser la vie politique en la démoralisant