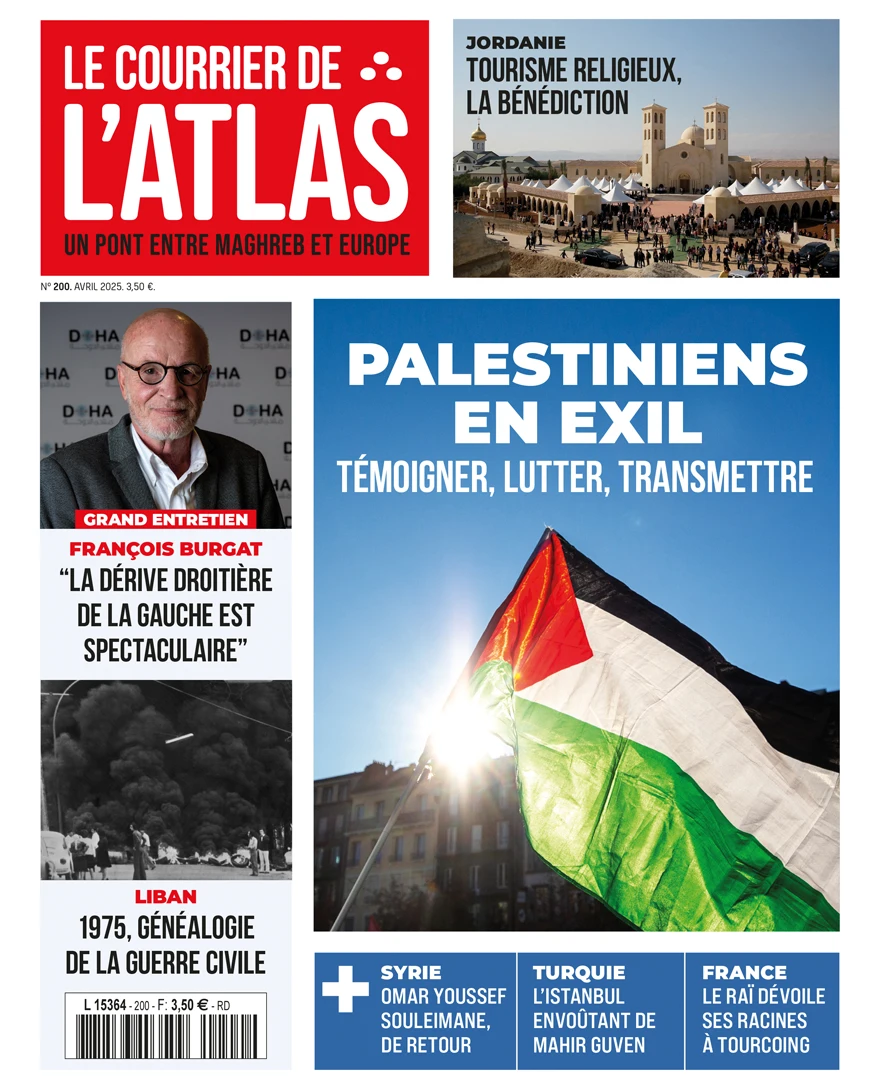Point de vue. L’horreur des procès politiques

Photo : Pixabay
Les procès politiques sont malheureusement connus pour être expéditifs et peu respectueux des formes. Un procès politique de ce type vient d’avoir lieu en Tunisie, procès dit du « complot contre la sûreté de l’État » contre des opposants.
La Tunisie vient de connaître un « procès » politique, qui sera sans doute gravé dans la mémoire collective des Tunisiens, notamment à l’ère des réseaux sociaux. Les procès politiques, qu’ils soient « révolutionnaires » ou « réactionnaires », sont tous horribles, tant judiciairement que moralement, légalement et politiquement. Danton n’a pas eu tort en disant : « Quand la politique entre dans le prétoire, la justice en sort. » Il faut dire qu’il parlait en connaissance de cause pour deux raisons au moins : d’abord, c’est lui qui a créé les « tribunaux révolutionnaires » ; ensuite, il a subi lui-même leurs foudres, puisqu’il a été emprisonné, puis guillotiné sous les ordres de son « frère d’armes » Robespierre, par ces mêmes tribunaux qu’il s’est ingénié à créer. Or, les tribunaux révolutionnaires, on le sait fort bien, ne sont des « tribunaux » que de nom, étant plus révolutionnaires que judiciaires et donc plus politiques que légaux. C’est le volontarisme, l’urgence, la fureur et l’idéologie politique qui prévalent d’ordinaire dans les soi-disant « procès » fabriqués par des pouvoirs politiques momentanément victorieux, contre des adversaires-ennemis politiques qu’on cherche à éradiquer définitivement. À l’évidence, toute notion de droit, de justice, d’équité ou de droit de défense est ravalée à la superfluité. En tout cas, lorsqu’un procès de ce type a lieu, il est souvent dénoncé comme une manœuvre visant à neutraliser des adversaires politiques plutôt qu’à rendre une véritable justice.
>> A lire aussi : Point de vue. Trump, personnalité charismatique ou médiatique ?
Dans un procès politique, on est brutalement condamné d’avance. Rarement, en effet, dans un procès politique, a-t-on vu des victimes, généralement des opposants politiques, des militants ou des hommes libres, faire valoir justement ou équitablement leurs droits, même à travers des avocats brillants ou une opinion alerte. Tant il est vrai qu’un procès politique est marqué de bout en bout par des irrégularités, comme dans le procès du dénommé « complot contre la sûreté de l’État » du 4 février en Tunisie, contre plusieurs opposants et militants politiques. Irrégularités délibérément décidées et suivies d’effet, allant de la tenue d’audiences à huis clos et l’absence des accusés au déni des droits de la défense, en passant par le processus expéditif des démarches, des procédures et de la représentation. En l’espèce, la société civile et les avocats avaient beau dénoncer la décision du déroulement d’un procès politique dont les conséquences étaient pourtant graves pour les accusés, en leur absence, qu’on a délibérément empêchés de comparaître pour des présupposés « risques d’ordre sécuritaire ». Peine perdue. Le procès a bien eu lieu comme le voulait le pouvoir, sans tous les prisonniers politiques, dont le transport de la prison au tribunal était jugé risqué par les services de sécurité ou par l’autorité politique. On craignait plutôt que leur transport puisse attiser, devant le tribunal ou à l’intérieur de la salle d’audience, une foule acharnée de « défenseurs », militants, membres de la société civile, opposants politiques, journalistes ou familles des prisonniers. C’est peut-être l’accueil ou l’acclamation des prisonniers par la foule à l’intérieur du tribunal, et la dénonciation chahutée de cette justice d’exception, qui inquiétait les persécuteurs impopulaires.
>> A lire aussi : Point de vue. Le nouvel ordre géopolitique
De toutes les manières, l’absence des opposants accusés dans un procès politique n’est à vrai dire une première ni en Tunisie ni dans l’histoire. Il est souvent arrivé, dans certains régimes autoritaires ou en démocratie en période de crise politique, que des opposants soient jugés en leur absence, que des procédures soient menées secrètement, sans aucun accès à la défense. Cela est certes contraire aux droits fondamentaux, notamment au droit à un procès équitable garanti par des textes comme la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 10) ou la Convention européenne des droits de l’homme (article 6).
Plusieurs procès politiques se sont en effet déroulés dans le passé sans la présence des accusés, pour des raisons aussi multiples que variées, d’ordre stratégique, répressif ou symbolique. Le régime de Vichy a ainsi jugé Charles de Gaulle par contumace en août 1940 pour trahison après son appel à la résistance depuis Londres. Il a même été condamné à mort en son absence.
De même, lors des grandes purges staliniennes (1936-1938), plusieurs accusés furent jugés sans être présents, parfois exécutés à l’avance ou contraints d’avouer leurs actes sous la torture avant d’être condamnés en leur absence. L’ancien criminel nazi Klaus Barbie a été jugé en 1987 à Lyon pour crimes contre l’humanité, mais cette fois, c’est lui qui a refusé d’assister à son procès. Il a été condamné en son absence. Lors de son procès en Irak en 2005-2006, après sa capture par les Américains, Saddam Hussein a été expulsé du tribunal à plusieurs reprises, et certaines audiences se sont tenues sans lui. Ce qui fait que ce sont moins les accusations portées contre lui qui ont retenu l’attention, que les procédures appliquées par un tribunal spécial irakien. Après sa fuite en 2011 et la chute de son régime après la révolution, l’ancien dictateur tunisien, Ben Ali, réfugié en Arabie Saoudite, a été condamné par contumace dans un procès pour corruption et abus de pouvoir. Certains indépendantistes catalans ont encore été jugés en Espagne en 2019 sans être présents, car ils avaient fui à l’étranger, notamment Carles Puigdemont, député du parlement de Catalogne, poursuivi, réfugié en Europe, mais jamais extradé.
>> A lire aussi :Point de vue. Contre-réformisme
Dans de nombreux cas, ces procès servaient à justifier une répression politique ou à donner une légitimité juridique à une décision déjà prise par le pouvoir. Il faut dire que les régimes autoritaires ou les dictatures ne sont pas les seuls à organiser des procès politiques en l’absence des accusés : les démocraties ont aussi connu ce type de « procédure » infamante, manifestement contraire aux droits de la défense. Un homme politique accusé, ancien dirigeant ou opposant, a pourtant droit, pas plus qu’un accusé de droit commun ou un justiciable ordinaire, à un procès équitable respectueux des formes.
D’ailleurs, l’absence des accusés peut s’expliquer d’une autre manière. Parfois, le pouvoir politique craint les discours et répliques percutantes des accusés, ainsi que leur médiatisation lors du procès. Le régime de Vichy, et notamment le maréchal Pétain, a voulu démontrer que ce sont certains dirigeants de la IIIe République, et notamment ceux de la gauche socialiste, qui étaient responsables de la défaite de 1940 contre les nazis. Ils ont alors organisé un procès politique, le célèbre « procès de Riom », contre certains dirigeants, dont Léon Blum et Édouard Daladier. Mais ces derniers, par la qualité de leur défense et leur riposte, ont retourné l’accusation contre les autorités du régime de Vichy. Ils ont mis en lumière le rôle du haut commandement de l’armée française, incapable, d’après eux, de préparer et de conduire cette guerre en raison d’une certaine rigidité doctrinale liée au manque d’évolution tactique. Au point qu’Hitler ait donné l’ordre d’interrompre ce procès, qui n’était plus en sa faveur.
>> A lire aussi : Point de vue. Hybridation de la plupart des régimes politiques
On peut penser alors que le président Saied, en dépit de sa détermination (néfaste), n’avait pas bonne conscience d’avoir organisé un procès politique en vue de régler ses comptes avec ses adversaires politiques, non pas sur le terrain politique, non pas électoralement, non pas dans des débats démocratiques loyaux, mais dans un prétoire défiguré, acquis à sa cause. Il craignait d’être accusé à son tour devant les médias nationaux et internationaux d’abus de pouvoir (les journalistes étaient d’ailleurs empêchés de rentrer dans la salle d’audience) par des accusés, tous des militants aguerris au discours politique. Dans de tels procès, les pouvoirs politiques, organisateurs de ces médiocres procès politiques et ayant beaucoup de choses à cacher, paraissent souvent en position de faiblesse morale face à leurs adversaires politiques, se réclamant du droit et de la justice, soutenus par la société civile, mais empêchés physiquement et légalement de se défendre. Seul l’accusateur avait voix au chapitre.
>> A lire aussi : Point de vue – Syrie. Vers un Etat islamiste « light »
La leçon à retenir des procès politiques, c’est qu’il ne faut jamais mépriser les « formes » ni les considérer comme une quantité négligeable, comme on a coutume de le faire, notamment au regard des questions de « fond », réservées aux âmes intelligentes. Ce n’est pas un hasard si un libéral lucide comme Benjamin Constant, qui a vécu les fureurs révolutionnaires, y a beaucoup insisté. Ce sont les formes qui permettent en effet de distinguer l’innocent du coupable. C’est pourquoi les systèmes libres et démocratiques sont attachés à leur respect. Il écrit : « Si les formes sont inutiles, pourquoi les conservez-vous dans les procès ordinaires ? Si elles sont nécessaires, pourquoi les retranchez-vous dans les procès les plus importants ? Ce sont des brigands, dites-vous, des assassins, des conspirateurs, auxquels seuls nous enlevons le bénéfice des formes ; mais avant de les reconnaître comme tels, ne faut-il pas constater les faits ? S’il en existe de meilleures ou de plus courtes, qu’on les prenne ; mais qu’on les prenne pour toutes les causes » (B. Constant, Principes de politique, Paris, Hachette, Pluriel, livre IX, ch. II, 1997 (1810), p. 162-163).