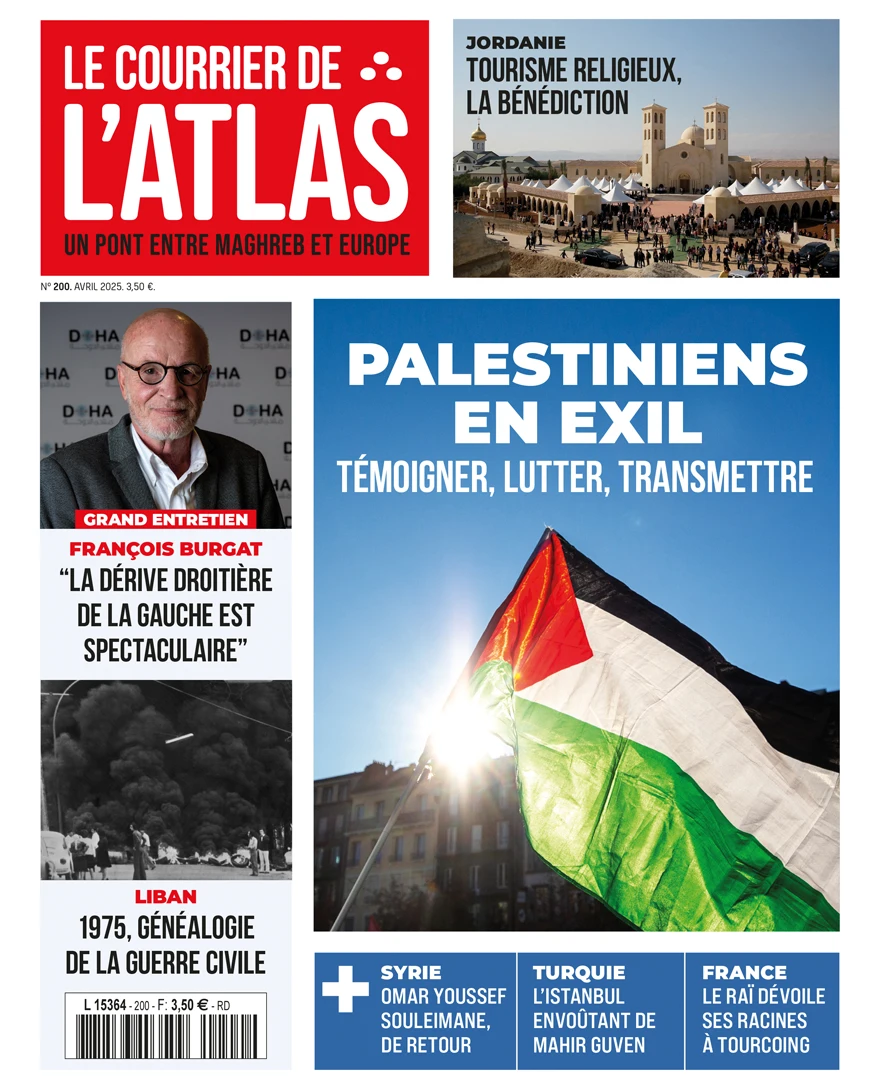« Khadija » contre l’État : une audience pour réparer l’oubli judiciaire

Ce mercredi 9 avril à 14h, le tribunal judiciaire de Paris se penche sur une affaire hors norme : celle de Khadija, victime de violences conjugales, qui assigne l’État pour les fautes commises dans son dossier. Derrière cette procédure, une question centrale : comment la justice a-t-elle pu abandonner une femme en plein cœur de son combat ?
En 2017, Khadija porte plainte contre son ex-compagnon pour des violences répétées et des viols. Ce dernier, Khalid B., a déjà été condamné à un an de prison en 2016 après avoir tenté de la défigurer. Une peine qui ne l’empêchera pas de récidiver à sa sortie. L’affaire remonte finalement jusqu’aux assises, en 2020, à Limoges. Mais Khadija n’y est pas.
« J’ai appris via les réseaux sociaux que son procès était en cours », racontait-elle à l’époque dans nos colonnes. En réalité, la justice a commis une erreur administrative : la convocation de la victime a été envoyée à une mauvaise adresse. Le retour d’huissier signalant l’anomalie n’a pas été pris en compte. L’audience est maintenue malgré tout. L’accusé est condamné à huit ans de prison pour violences, mais acquitté pour les faits de viol. La partie civile n’a jamais pu s’exprimer.
« Je n’ai pas pu donner ma version des faits. J’aurais aimé faire entendre ma voix, exprimer mes souffrances, faire part de mes craintes », nous confiait-elle, bouleversée.
Pour Me Pauline Rongier, son avocate, les fautes sont multiples : convocation irrégulière, absence d’observation du parquet, refus du report de l’audience malgré la demande expresse de Khadija. « C’est une accumulation de dysfonctionnements incompréhensibles. Khadija a été littéralement privée de procès. »
Privée d’audience, elle a aussi été privée de tous ses droits de partie civile : être entendue, être assistée, demander le huis clos, poser des questions, produire des pièces, citer des témoins, plaider. Et les conséquences sont profondes. « L’acquittement sur les faits de viol a renforcé chez son agresseur un sentiment de toute-puissance », alerte Me Rongier.
Depuis sa sortie de prison en février 2024, et son expulsion vers le Maroc, Khalid B. n’a cessé de harceler Khadija. Menaces, intimidations, tentatives de localisation : la peur est toujours là. La porte de son domicile a récemment été défoncée. Elle a porté plainte à cinq reprises. En vain.
Face à l’inaction, Khadija dit vivre un cauchemar sans fin. « Il trouve toujours le moyen de me localiser, même via les réseaux sociaux », expliquait-elle récemment. « Je ne veux plus vivre dans la peur. J’ai besoin qu’on m’écoute, qu’on comprenne que ma vie est encore en danger. »
Mais au-delà des fautes humaines, c’est un vide juridique que pointe son avocate. Le droit de la partie civile à être présente au procès est reconnu, mais aucune garantie n’est prévue en cas de défaillance. Surtout, aucun recours n’est possible contre une décision d’acquittement, même rendue dans des conditions irrégulières.
« La décision, pourtant rendue en violation des droits les plus élémentaires de la victime, est aujourd’hui considérée comme définitive », déplore Me Rongier.
Connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Khadija la Combattante, la jeune femme de 34 ans, marquée à vie par les violences qu’elle a subies — viols, coups, côtes cassées, oreille arrachée, séquestration — ne se bat plus seulement pour elle. Elle espère que son histoire servira à en protéger d’autres.
« J’ai survécu à tout ça. Maintenant, j’attends que la justice me reconnaisse. »